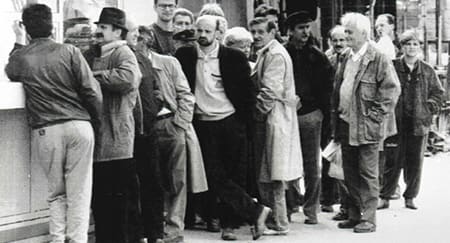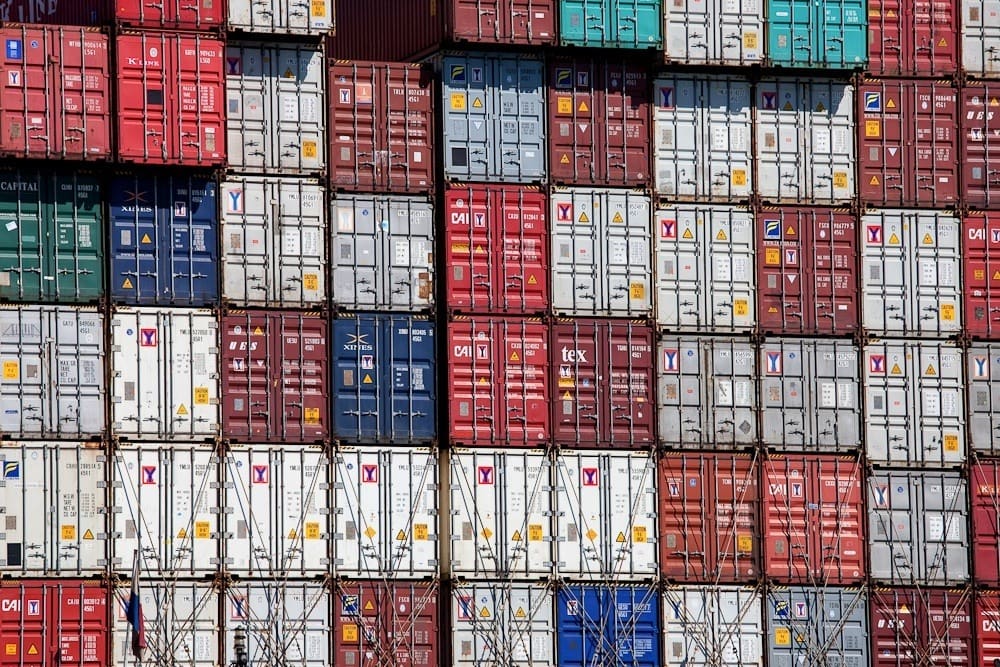L’insécurité alimentaire touche toujours durement certaines parties du monde. Cependant, le problème principal n’est pas la quantité totale de nourriture disponible mais bien la répartition appropriée de cette nourriture. On pourrait sauver des millions de vies et réduire les conflits simplement en modifiant cette répartition.
La sécurité alimentaire ne va pas de soi. Les citoyens de nombreux pays de l’OTAN ont grandi en considérant la disponibilité de nourriture comme un fait acquis, or, à une époque pas si lointaine, l’Europe a connu des difficultés d’approvisionnement alimentaire. La Deuxième Guerre mondiale a provoqué de graves problèmes de cette nature dans de nombreuses régions et, après la guerre, le système communiste imposé à l’Europe de l’Est jusqu’en 1990 ne permettait pas aux consommateurs d’avoir accès à tous les produits alimentaires qu’ils souhaitaient. Les pénuries alimentaires peuvent être générées par la guerre, les attentats terroristes contre la chaîne d’approvisionnement, les catastrophes naturelles, les maladies, la contamination des aliments et la mauvaise gestion économique, avec une inefficacité de la planification et/ou des prix hors de portée pour les consommateurs.
L’approche stratégique globale de l’OTAN prévoit que les États membres doivent se concentrer de plus en plus sur les besoins sécuritaires des citoyens et des sociétés civiles ; il s’agit donc d’un concept de défense totale, qui n’est plus axé étroitement sur la diplomatie internationale et le matériel militaire utilisé pour les conflits conventionnels du passé. Or, la sécurité alimentaire est une prérogative pratiquement exclusive des institutions civiles, comme le département de l’Agriculture des États-Unis, la Direction générale de l’agriculture de l’Union européenne et les ministères nationaux de l’Agriculture.
Sécurité alimentaire et sûreté alimentaire sont deux choses distinctes. La sécurité alimentaire signifie que l’ensemble de la population dispose en permanence, quelles que soient les circonstances, d’approvisionnements alimentaires fiables. C’est une question hautement stratégique car sans nourriture la population ne peut tenir très longtemps. En revanche, la sûreté alimentaire est un sujet plus « civil » qui concerne la qualité de la nourriture destinée à la consommation humaine, sa valeur nutritionnelle, l’hygiène alimentaire, les effets à long terme sur la santé, l’utilisation d’additifs dans la production, et d’autres questions similaires.
La nourriture peut être utilisée comme une arme, tant dans les guerres conventionnelles avec une ligne de front que dans les guerres que mènent les terroristes de nos jours. La guerre de Bosnie, au début des années 1990, a constitué une illustration récente de cette utilisation dans un conflit conventionnel avec une ligne de front. La fermeture complète d’une région ou d’une ville assiégée en restreignant ses approvisionnements alimentaires s’est alors révélée être une arme de coercition politique aussi efficace que les bombardements d’artillerie. En l’occurrence, les deux moyens – étranglement de la chaîne d’approvisionnement alimentaire et bombardements d’artillerie – furent souvent utilisés de concert.
On peut citer à titre d’exemple de terrorisme alimentaire la contamination au mercure des oranges israéliennes de Jaffa par les Palestiniens il y a trois décennies. Le but des Palestiniens était de créer une panique afin de nuire à l’économie du pays, les oranges de Jaffa étant une marque israélienne bien connue. La nouvelle de l’empoisonnement a d’ailleurs bien créé une grande frayeur, finalement disproportionnée par rapport au faible nombre d’oranges effectivement contaminées.
On ne saurait contester le fait que les États doivent détenir des réserves stratégiques de nourriture pour le cas où des problèmes imprévus de sécurité ou de sûreté alimentaire surviendraient. Ce système s’est déjà avéré très efficace en Europe et en Amérique du Nord - des problèmes de sûreté alimentaire tels que la présence de dioxine dans du lait ou la maladie de la vache folle, se sont posés mais ils ont pu être réglés aisément sans provoquer de famine ou de difficultés d’approvisionnement. Mais pour se prémunir contre des phénomènes imprévus ou inopinés, il faut qu’il y ait une certaine surproduction de nourriture, qui a un coût élevé mais dont on ne peut pas faire l’économie. C’est comme une prime d’assurance à payer pour le cas où le pire se produirait - et la nourriture est la chose la plus importante dont les êtres humains ont besoin, outre l’air et l’eau. C’est onéreux, et les politiques agricoles de nombreux pays industrialisés absorbent souvent directement ou indirectement 1 à 2% du PIB, soit l’équivalent du budget de la défense de certains États.
De surcroît, il faut se débarrasser de temps en temps de cette surproduction alimentaire, et jeter de la nourriture est souvent considéré comme politiquement incorrect dans un monde où beaucoup souffrent de pauvreté et de famine. Les particuliers font à intervalles réguliers le tri des produits alimentaires qu’ils détiennent depuis longtemps dans leur cuisine, et les gouvernements doivent eux aussi écouler de temps à autre les stocks stratégiques qu’ils détiennent dans leurs systèmes nationaux d’approvisionnement alimentaire afin de les renouveler. Une partie de la surproduction stratégique est exportée, souvent à l’aide de subventions financées par le contribuable, et une partie est donnée au titre de l’aide alimentaire aux pays pauvres. Ces dons de nourriture, ou ces ventes de denrées à prix de dumping, semblent être une bonne option sur place, mais en réalité elles sapent la production alimentaire des pays bénéficiaires et entretiennent la dépendance à l’égard des « généreux » pays donateurs. Aider les pays pauvres à s’aider eux-mêmes est une option préférable aux simples dons de denrées à consommer, sauf dans des situations ponctuelles de famine nécessitant une action urgente.
Nombreux sont ceux qui feront valoir qu’en toute bonne logique la surproduction de nourriture n’est pas nécessaire et que si l’on a besoin de denrées supplémentaires on peut les acheter sur les marchés mondiaux. Il est vrai que limitation des denrées alimentaires signifie rarement absence de telles denrées, et que les riches peuvent toujours se permettre de se nourrir à volonté. Néanmoins, la fiabilité des marchés mondiaux pose problème. Lorsque les prix des denrées alimentaires se sont inopinément envolés à la fin de la dernière décennie, certains gouvernements ont imposé des restrictions à l’exportation pour brider les prix intérieurs afin d’aider leurs populations qui avaient du mal à se nourrir au quotidien et ne pouvaient rivaliser avec les riches Occidentaux. En cas de panique alimentaire, les marchés mondiaux ne constitueraient pas une source de denrées fiable pour les pays de l’OTAN. Dans le passé, les gouvernements ont souvent eu recours au rationnement alimentaire de leur population lorsque les approvisionnements étaient limités. Il est toutefois évident que le rationnement s’accompagne souvent d’un marché noir pour ceux qui peuvent se le permettre. Après tout, la nourriture doit non seulement être disponible, mais elle doit aussi être abordable, et le fait d’avoir des réserves abondantes maintient les prix bas.
D’un point de vue économique, il est tentant d’acheter à l’extérieur de la nourriture moins chère que celle qui est produite à l’intérieur, mais il faut mettre en balance les économies ainsi réalisées et le risque de dépendance à l’égard des importations de denrées stratégiques. Il n’est pas bon d’être tributaire de l’extérieur pour les approvisionnements pétroliers, mais être tributaire de l’extérieur pour les approvisionnements alimentaires est pire encore. La hausse des dépenses militaires qu’exigerait la protection des approvisionnements alimentaires vitaux atteindrait rapidement le niveau de la part absorbée par l’agriculture dans les pays industrialisés – 1 à 2% du PIB, de la même manière que les dépenses militaires mondiales liées à la protection des approvisionnements en pétrole et en gaz qui ne peuvent être produits au plan intérieur se chiffrent en milliards. Les échanges commerciaux sont une bonne chose, mais ils doivent être mis en balance avec les intentions stratégiques.
Dans les années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, l’Europe était importatrice nette de nourriture. Aujourd’hui, la situation s’est inversée et l’actuelle Union européenne est exportatrice nette de nourriture, comme l’Amérique du Nord. Être exportateur net ne tient pas uniquement aux flux sortants de denrées. Le commerce international des denrées alimentaires, importations et exportations, est considérable étant donné que différents types de nourriture sont produits dans différentes parties du monde où les conditions naturelles sont meilleures qu’à domicile. La fourniture de toute la gamme des denrées alimentaires ne peut être assurée que par le biais des échanges internationaux, même si une réserve stratégique de denrées de base peut et doit être produite à l’intérieur.
S’il est, certes, bon de disposer d’un approvisionnement national en denrées stratégiques comme les produits alimentaires de base, la production intérieure et la distribution de nourriture dans le monde industrialisé ne sont toutefois possibles que si les approvisionnements énergétiques sont abondants. Sans pétrole, les tracteurs des exploitations agricoles et les camions qui acheminent la nourriture vers les consommateurs seront vite à l’arrêt. Les biocarburants ne représentent qu’une solution partielle. Il s’agit essentiellement de diesel fabriqué à partir de graines. La production locale de diesel peut sembler constituer une option intéressante, mais c’est également un facteur important de la hausse du prix des denrées alimentaires. Si les voitures entrent en concurrence avec les êtres humains au niveau de la nourriture, ce sont les plus pauvres de la société qui en pâtiront car ils auront de plus en plus de mal à régler leur facture alimentaire. Par ailleurs, à un moment donné les réserves pétrolières mondiales seront épuisées et il faudra bien trouver d’autres énergies – mais ce ne sera le cas que dans plusieurs décennies, sinon plus.
Le problème à long terme le plus sérieux est celui de la croissance exponentielle de la population mondiale – celle-ci était d’un milliard d’individus en 1800, d’un milliard et demi en 1900, de 3 milliards en 1960, et de 6 milliards en 2000 ; elle est de 7 milliards au moment où ces lignes sont rédigées, et devrait atteindre 9 à 10 milliards en 2050. La consommation de nourriture et d’énergie des 10 milliards d’êtres qui peupleront la planète en 2050 ne sera pas équivalente à dix fois celle du milliard de consommateurs de l’année 1800 ; elle sera largement supérieure. L’homme moderne ne se contente, en effet, pas d’une tranche de pain ou d’un bol de riz alors qu’il peut manger de la viande, du poisson, des légumes exotiques ou d’autres types de nourriture. Mais pour obtenir un kilo de viande, il faut beaucoup plus de céréales que si l’Homo sapiens avait mangé directement lui-même les céréales au lieu de s’en servir pour nourrir l’animal et manger ensuite cet animal. La pression sur la production de base comme sur les systèmes de distribution sera donc considérable à l’avenir. Il est temps de s’inscrire dans une optique prospective, et les bonnes terres agricoles vont revêtir une importance croissante dans les décennies à venir.