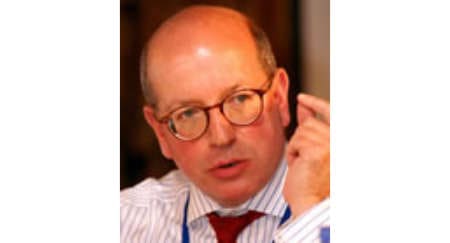James Sherr, de Chatham House, estime que la différence de perception entre les deux pôles de la relation OTAN-Russie continue de conduire les parties à des résultats inopportuns. Et il en sera, selon lui, ainsi jusqu'à ce que chaque partie accepte la vision de l’autre concernant la signification de la sécurité.
Ces dernières années, nombreux sont ceux qui se sont demandé, avec raison, si le terme partenariat OTAN-Russie allait enfin pouvoir revêtir une signification. La pause dans le processus d'élargissement, la réactivation du Conseil OTAN-Russie, la relance des relations américano-russes, les nouveaux accords START et l'intensification de la coopération en Afghanistan ont donné corps à ces espoirs.
Mais - ce n'est pas un secret - il manque quelque chose dans ces relations. Pour Bruxelles, le chaînon manquant, c'est la confiance. Pour Moscou, c’est l'égalité.
Ce sont là des perceptions très différentes, et elles devraient inciter à une modération des attentes. Malgré les améliorations intervenues, les points de vue de l'OTAN et de la Russie sur ce qui préserve la sécurité européenne et ce qui la menace demeurent résolument dissemblables. Ils portent aussi l'empreinte de cultures sécuritaires très différentes. Tant que cela persistera, la Russie aura du mal à faire confiance à l'OTAN, et les membres de l'Alliance se montreront extrêmement réticents à offrir à la Russie le type d'égalité qu'elle souhaite. Dans la limite de ces paramètres, une relation productive et coopérative est possible. L'harmonie ne l’est pas.
Pour la Russie, égalité signifie cogestion
Fondamentalement, l'OTAN n'a jamais mis en cause l'égalité de la Russie. La Russie est le partenaire prioritaire de l'Alliance. Aucun Allié ne cherche à diminuer son autonomie ou à limiter ses prérogatives. L’Acte fondateur OTAN-Russie exclut tout «droit de veto sur les actions de l'autre partie» et toute restriction du « droit de l’OTAN ou de la Russie de prendre des décisions et de mener des actions de manière indépendante ».
Mais pour la Russie, égalité signifie cogestion ; le président de la Commission des Affaires étrangères de la Douma, Konstantin Kosatchev, a indiqué qu’il fallait que la Russie soit membre à part entière du « club euro-atlantique » et puisse réellement influer sur le processus décisionnel. De l'avis des dirigeants du pays, la Russie a droit à cette égalité en vertu de sa contribution à la fin de la Guerre froide, de sa dissolution du Pacte de Varsovie et de son importance stratégique.
Dans le même temps, selon les termes de Vladimir Poutine lorsqu’il était président, la Russie a « gagné le droit de rechercher son intérêt propre». Elle a droit à l’égalité dans la différence ; elle a le droit de rester, selon la formule du ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, un «centre de valeurs» autonome. Pour Moscou, en ignorant ces revendications, en rapprochant des « infrastructures militaires » des frontières russes et en refusant de renoncer à la possibilité d'un nouvel élargissement, l'OTAN ravive la division de l'Europe.
Au sein de l'Alliance, beaucoup ont la même vision de la Russie et considèrent qu’en signant la Déclaration de Budapest de l'OSCE, en 1994, et l’Acte fondateur, en 1997, elle a affirmé son « respect de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de tous les États et de leur droit inhérent de choisir les moyens d’assurer leur sécurité », et qu’elle a également renoncé aux «sphères d'influence».
Or la diplomatie russe a souligné de manière nuancée d’autres éléments, à savoir que «la sécurité est indivisible» (Charte de Paris de 1990) et que les États ne doivent pas « rechercher leur intérêt national en matière de sécurité aux dépens d’autres États » (Déclaration de Budapest de 1994). Sur la base de ces principes, le président Medvedev insiste sur le fait que le système de sécurité de l'Europe ne doit pas conduire à des « zones dont les niveaux de sécurité sont différents », ce qui soulève la question de savoir si les États ont le droit d'entrer dans des « zones » ou de les quitter.
En confinant les engagements aux questions de « sécurité dure » et en ignorant les menaces politiques et économiques dans son projet de Traité sur la sécurité européenne de 2009, la Russie se démarque non seulement vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi vis-à-vis de l'OSCE, dont le processus de Corfou insiste sur le dialogue concernant «tous les aspects de la sécurité».

Accepter d’être partenaires – en 1997, une nouvelle voie a clairement été tracée pour l'OTAN et la Russie
Dans ses déclarations internes et bilatérales, la Russie adopte une position beaucoup moins nuancée. Du premier document politique sur « l’étranger proche », en 1992, à l'invocation par le président Medvedev d'une « sphère d'influence privilégiée », en 2009, la Russie a laissé entendre qu'elle a le droit de limiter la souveraineté de ses voisins. Dans l’appel qu’il a lancé, en août 2009, au président ukrainien de l’époque, Viktor Iouchtchenko, Dmitri Medvedev lui reprochait de vouloir ignorer les « fondements de la coopération » en sapant « l’histoire, la culture et la religion communes » des deux pays et les principes d’une «coopération économique étroite», et en «s’obstinant à poursuivre son objectif d’adhésion à l'OTAN». Trois mois plus tôt, le premier ministre Poutine avait qualifié de «crime» les tentatives de l'Ukraine («petite Russie») pour s’affranchir de la Russie.
Les habitués des négociations avec la Russie verront une certaine gesticulation dans ces positions, et il y a de cela. Mais il s’agit des politiques russes et non de manœuvres tactiques, et elles expriment – de manière remarquablement cohérente – des intérêts étatiques.
Il serait avisé de tirer cinq conclusions.
Premièrement, nous ne devons pas supposer que les améliorations intervenues récemment dans les relations vont inciter la Russie à accepter la place de l'OTAN dans le monde. Dans la dernière doctrine militaire russe, l'Alliance figure en tête de liste des « dangers militaires » auxquels le pays est confronté. La défense contre les missiles stratégiques est également considérée comme un « danger militaire ». La doctrine a été publiée en février 2010, soit dix-huit mois après la mise en veilleuse du processus d'élargissement. Elle est en totale contradiction avec le Concept stratégique de l'OTAN, qui déclare que « la sécurité de l'OTAN et celle de la Russie sont indissociablement liées ».
Dans de nombreux domaines, la Russie est un partenaire incontournable. Mais elle restera un partenaire difficile
Deuxièmement, nous ne devons pas supposer que la coopération va être cumulative ou que la conclusion d’un accord va créer une dynamique pour la conclusion d’autres accords. Le nouveau Traité START n'a pas facilité la réalisation de progrès dans les négociations sur la défense antimissile et, pour le moment du moins, l’appel du Sénat américain à des négociations sur les armes substratégiques a été fermement rejeté. Nous ne devons pas davantage penser que la Russie va considérer la poursuite de sa coopération avec l'OTAN comme une fin en soi. Pour Moscou, les négociations et les efforts conjoints ne sont pas des exercices de thérapie de groupe, mais des moyens de faire avancer les intérêts nationaux. La coopération dans certains domaines en Afghanistan (comme les approvisionnements et le transit) n’exclura pas des approches contradictoires dans d'autres (par exemple les droits concernant l’installation de bases et la sécurité régionale).
Troisièmement, nous ne devons pas supposer que le besoin de «modernisation» et d’investissements étrangers va modérer les comportements de Moscou vis-à-vis de l'Alliance. Il ya des liens très nets entre les contraintes au niveau des ressources, l'incapacité administrative et les insuffisances des forces armées conventionnelles russes. Mais les revers enregistrés concernant la réforme engagée par le ministre de la Défense, Anatoli Serdioukov, n'ont fait qu’intensifier l’hostilité à l’égard de la défense antimissile de l’OTAN et l'opposition à de nouvelles réductions des armes nucléaires.

Défense antimissile – va-t-elle engendrer davantage de coopération, ou davantage de sources de désaccord?
Quatrièmement, nous ne devons pas sous-estimer l'influence de nos valeurs et de nos traditions respectives. Depuis trois générations, l'état d’esprit des démocraties occidentales a été façonné par la recherche du consensus, la prise de décisions collective et «des habitudes de coopération» qui visent à concilier intérêt national et intérêt commun. Aujourd'hui, l'OTAN et l'UE veulent instaurer un ordre sécuritaire post-Guerre froide défini non par des lignes sur des cartes, mais par la liberté des États de choisir leurs partenaires et leur mode de développement. Elles estiment aussi qu'en certaines occasions les valeurs « universelles » doivent être défendues au-delà de leurs frontières. La Russie ne partage pas cette tradition. C'est un État qui se veut résolument moderne, sans ajouts postmodernes. Il conserve une vision implacablement géopolitique de la sécurité, continue de défendre sans complexe les sphères d'influence, a une foi inébranlable dans la souveraineté et se méfie ouvertement du «messianisme occidental».
Cinquièmement et, par extension, nous devons être prêts à admettre que certaines des politiques auxquelles nous tenons le plus sont en contradiction avec les convictions de Moscou sur ce qu’elle est en droit de revendiquer. Le soutien de la « liberté de choix » des voisins de la Russie peut être bénéfique pour l'Europe, mais il est en contradiction avec les intérêts de la Russie tels qu’elle les définit actuellement. Aux yeux d’une institution militaire pour laquelle sécurité équivaut à maîtrise de « l'espace », la présence de forces de l'OTAN « à proximité des frontières russes » constitue un « danger militaire », quelles que soient nos intentions.
Ces conclusions ne doivent pas porter atteinte à la priorité que l'OTAN attache à ses relations avec la Russie. Au contraire, elles doivent renforcer la détermination de l'Alliance à approfondir la coopération dans les secteurs où les intérêts convergent et à limiter les divergences aux secteurs où il y a vraiment désaccord.
Dans de nombreux domaines, la Russie est un partenaire incontournable. Mais elle restera un partenaire difficile.
La mesure dans laquelle elle appuiera la politique de l'OTAN ou s’y opposera sera strictement fonction de ses intérêts propres. Cela étant, nous pouvons parvenir à des résultats présentant certes des limites, mais néanmoins importants. Si nos attentes vont au-delà, nous seront inévitablement déçus.